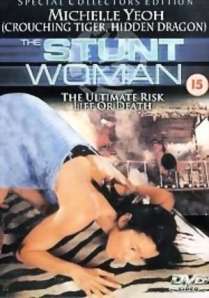Séance « Cinéma dans le Cinéma ».
Après plus d’un mois d’interruption (dernière séance le 5 mai), voici le Retour des Projections Chez Jacki.
J’ai pu entretemps aller au cinéma voir quelques bons films en salle (+quelques achats DVD intéressants), pour garder mon rythme de cinéphile, dont certains d’ailleurs très intéressants et que je vous invite à aller regarder (voir comptes-rendus).
Mais recentrons nous sur nos projections Chez Jacki, pour une soirée de cinéphiles purs et durs (une petite équipe, noyau dur composé Jacki, Mimi, Manu et Eddie). On présente donc ce soir deux films qui parlent de cinéma, chacun à leur manière, pour deux visions très différentes du 7e Art et de sa fabrication.
On commence donc à Hong Kong et son cinéma typique très porté sur l’action et les cascades, avec le film Stuntwoman d’Ann Hui On Wah (1996).
Ann Hui est une cinéaste hongkongaise méconnue en France, et pourtant elle est une auteur importante de la Nouvelle Vague hongkongaise.
La Nouvelle Vague du cinéma de Hong Kong nait au début des années 80, avec des réalisateurs comme Tsui Hark, Stanley Kwan, Ann Hui, Ringo Lam, Kirk Wong, Patrick Tam, Alex Cheung, Eddie Fong, Clara Law, Lawrence Ah Mon, etc.
Il s’agit pour eux de révolutionner et renouveler le cinéma de Hong Kong, et le sortir des carcans des studios Shaw Brothers ou leurs rivaux, et de la politique du cinéma de genre et d’exploitation, tout en s’inscrivant dedans, malgré leur vision d’un cinéma plus porté sur les auteurs. A cette période, à l’initiative de Tsui Hark, nait la société de production Film Workshop, à qui l’on doit notamment l’éclosion et l’expansion du cinéma mythique de John Woo entre autre. L’œuvre d’Ann Hui (qui a cependant participé à de prestigieuses productions de films d’action comme Swordsman en 1990 et Fong Sai Yuk en 1993, et de nombreux films en actrice), quant à elle, est plus portée sur un cinéma social et d’auteur engagé (très différent des habituelles productions hongkongaises). Après une formation à la télévision, où elle met en place son style, elle réalise depuis 1979 (The Secret, thriller inspiré d’un fait réel et The Spooky Bunch en 1980, film d’opéra chinois et de fantômes) des films (plus d’une vingtaine de longs métrages) qui sont une véritable étude sociale des thèmes de l’identité, de la guerre, de l’émigration, avec une mise en scène à la fois réaliste et épurée, proche du documentaire, mais aussi très sophistiquée. La réalité est un aspect important et essentiel de son cinéma.
Dans Stuntwoman, Ann Hui nous montre tout l’envers du décor et la réalité du cinéma de Hong Kong, et la manière dont il est fabriqué et produit. Problèmes de tournages, et conflits entre les équipes, description précise et détaillée du métier de cascadeur et celui de chorégraphe et son équipe, mise en place des scènes d’action et de cascades, plan-séquence qui livrent une visite guidée parmi les figurants divers sur un plateau de tournage hongkongais, faux-décor pour un film en costumes typique de Hong Kong, description du monde du cinéma et de ses techniciens (très proche de celui des gangsters qui d’ailleurs financent le film sur lequel les héros travaillent et les menacent s’ils ne finissent pas à temps), de leurs beuveries, leurs galères, leur amitié et leur solidarité au sein de l’équipe dirigée d’une main ferme et paternelle par le charismatique Sammo Hung (énorme et trop classe dans ses vestes sans manches ouvertes sur son gros bidon et ses superbes casquettes thaïlandaises). Michelle Yeoh est touchante et gracieuse, mais à cause d’une réelle blessure (lien étroit et ironique entre réalité et fiction) sur le tournage de Stuntwoman lors d’une cascade (celle du saut du pont sur un camion qui roule j’ai cru comprendre), elle occulte très vite tout l’intérêt du film (à savoir les tournages et leur description). Suite à cette blessure et aux complications engendrées, la réalisatrice décide de changer son scénario pour se centrer plus sur le personnage d’Ah Kam, et les relations de l’héroïne avec un playboy chinois pour un mariage raté, et avec le fils de Tung/Sammo Hung, qui meurt de manière impromptue et surprenante, suite à une pirouette scénaristique saugrenue (attaqué par un gangster ridicule et caricatural). Dans la seconde et la dernière partie, le ton du film devient plus alambiqué, par un mélodrame de dernière minute qui ne rehausse pas l’histoire. Celle-ci a bien commencé et a quelques moments forts et sympathiques, mais on sent que la cinéaste perd progressivement le contrôle de son œuvre, à mesure que l’histoire s’enfonce dans l’absurde (la fin sur le bateau pirate dans le parc d’attraction, totalement clichée, montre bien que la frontière entre réalité et fiction est définitivement franchie, avec Michelle Yeoh qui exécute des mouvements totalement surhumains et fantasmés, alors que c’est son métier dans le film de le suggérer. Bizarre mise en abyme). Sinon, mis à part toutes ses faiblesses, ce film est vraiment à voir, et reste intéressant pour ce qu’il nous apprend sur le cinéma de Hong Kong, si souvent mythifié et mystifié.
Je ne connaissais aucun des films de la cinéaste, et Stuntwoman me donne envie de découvrir plus en profondeur l’œuvre d’Ann Hui On Wah, réalisatrice trop peu connue en Occident, mais qui mériterait de l’être. J’ai regardé quelques bandes annonces de ses films (seule matière accessible), notamment celles de Night and Fog (2009) avec Simon Yam qui bat sa femme dans un rôle à contre courant et Jade Goddess of Mercy (2004) une histoire d’amour, et puis Boat People (1982), Story of Woo Viet (1981) et Song of the Exile (1990), films moins récents.
Une œuvre à découvrir.
http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=8210&display_set=eng
http://www.cinemasie.com/fr/fiche/oeuvre/ahkam/
http://www.imdb.com/title/tt0115485/
http://www.variety.com/review/VE1117432515.html?categoryid=31&cs=1&p=0
http://www.bbc.co.uk/films/2001/06/19/the_stunt_woman_1996_review.shtml
http://www.chinesecinemas.org/ahkam.html
http://www.hkcinemagic.com/fr/movie.asp?id=9
http://asia.cinemaland.net/html/actrice/michelle_yeoh.htm
http://www.allmovie.com/work/the-stunt-woman-154697
http://www.sogoodreviews.com/reviews/thestuntwoman.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann_Hui
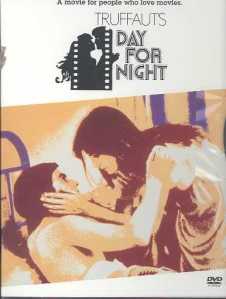
C’est intéressant de le programmer et de le mettre en relation avec La Nuit Américaine de François Truffaut (1973), second film proposé ce soir, sur la même thématique du « cinéma dans le cinéma » et du « film dans le film ».
‘La Nuit américaine’ est un véritable hommage à la technique cinématographique, contenu dans le titre même du film, qui désigne un procédé de tournage d’une scène de nuit en plein jour (illusion du cinéma). C’est aussi le manifeste de la Nouvelle Vague, qui déclare la fin du tournage en studio pour aborder le cinéma avec plus de réalisme et de proximité.
Truffaut nous livre avec ce film une description détaillée et minutieuse d’un tournage, et d’un plateau de cinéma en France (les studios de Nice plus précisément) avant la Nouvelle Vague et sa politique d’auteurs, et l’arrivée de nouvelles technologies qui permettent de faire du cinéma à moindre frais, avec des moyens et des équipes plus légers. Il nous parle d’un monde révolu et dépassé, celui du cinéma de studio, avec une grande nostalgie (cependant ce monde ne me semble pas si lointain, car les rapports humains décrits par Truffaut sur ce tournage de fiction sont si proches de la réalité, même aujourd’hui, des tournages et du cinéma). Tout au long du film, on sent l’amour de Truffaut pour le cinéma. C’est même une véritable mise en abyme de sa propre vie et expérience cinématographique, puisqu’il se met lui-même en scène dans le rôle du réalisateur, qui se pose des questions sur le sens de son métier, ses enjeux et ses contraintes, le problème de la création d’une œuvre, de la collaboration nécessaire avec une équipe (le cinéma ne se fait pas seul), et des rapports entre les différents membres de celle-ci, et comment concilier et fédérer tous ces individus, toutes ces personnalités autour d’un projet de film, véritable aventure humaine.
Connaissant l’univers des plateaux de tournages, on s’identifie totalement au personnages et leurs problèmes, on comprend de quoi parle Truffaut, qui sait parfaitement restituer l’ambiance effervescente de la fabrication d’un film, et ses situations et personnages spécifiques (les acteurs , leurs égos et leurs problèmes, le technicien/régisseur/accessoiriste boute-en-train et râleur, le réalisateur et ses problématiques de créateur, le producteur et son phrasé efficace et parcimonieux à l’image de ses préoccupations économiques de production, et surtout les filles du tournage : maquilleuse, scripte, assistantes, qui heureusement apportent une touche de fraicheur sur le plateau et désamorcent la tension).
Bon mais sinon, Jean Pierre Léaud, qu’est ce qu’il est relou dans le rôle d’Alphonse, acteur imbu, emphatique, surjoué. Pendant tout le film, dès qu’il ouvre la bouche (et même quand il l’ouvre pas), on a trop envie de le baffer. On comprend pourquoi il se fait larguer comme une merde.
Mais c’est vraiment un bon film sur le cinéma, fait par un amoureux obsessionnel de cinéma (ce petit garçon qui vole les photos du film Citizen Kane, et puis toute ces références et citations cinématographiques que je ne saurais relever, on sent toute l’érudition cinéphilique de Truffaut), et qui détaille très justement l’univers et l’ambiance de ce monde particulier. On voit les studios et les décors au début, et un peu le travail des techniciens, mais le film est nettement plus centré sur l’équipe mise en scène et les relations entre les membres de cette équipe au cœur du film. Un film qui donne vraiment envie de faire du cinéma. D’ailleurs, c’était encore plus intéressant de le regarder avec dans la tête la conception de CLAP, projet en cours d’écriture, de série courte sur le cinéma. Ce film est véritablement une référence pour l’écriture de ce projet, même si j’aimerai accentuer plus dans CLAP la dimension technique du cinéma. Une soirée cinéphilique très intéressante, qui m’a permis de me remettre ce projet de scénario en tête.
En attendant la fiche de Jacki, voici quelques liens et photos qui parleront plus que mon maigre avis sur La Nuit Américaine, que j’ai adoré voir. (Ça m’a d’ailleurs donné envie de voir Les 400 Coups et d’autres films de Truffaut) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_am%C3%A9ricaine_(film)
http://french.imdb.com/title/tt0070460/combined
http://www.critikat.com/La-Nuit-americaine.html
http://1001filmsavoir.blogspot.com/2008/10/101-truffaut-la-nuit-amricaine.html
http://films.blog.lemonde.fr/2007/03/23/nuit-americaine/
http://www.film-a-voir.com/2007/06/la-nuit-amricaine.html
http://www.cinemagora.com/film-3341-la-nuit-americaine.html
http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr/index.php?pk=51577
http://www.cine-memento.fr/nuit-americaine-p-1180.html
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/truffaut/nuitamericaine.htm
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/livres/cinemaction124cinemaaumiroirducinema.htm
Quelques phrases mythiques aussi :
« Je laisserais un mec pour un film mais jamais un film pour un mec » la scripte, Nathalie Baye trop choubi
« Si on voulait gagner de l’argent, on ferait pas du cinéma » le producteur joué par Jean Champion

Voila pour ce compte rendu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiliques.
La prochaine fois, Manu nous présentera son programme et ses premiers films.
Eddie, le 25 juin 2009.